Uranium nigérien : nationalisation, opacité et bras de fer juridique avec Orano
Par Stive R. Makanga
Le bras de fer qui oppose Orano à l’État nigérien autour de l’exploitation de l’uranium ne relève plus seulement d’un différend industriel ou financier. Il s’est mué, au fil des mois, en un dossier hautement politique, saturé de discours souverainistes, d’accusations environnementales et de décisions unilatérales dont la cohérence juridique interroge. Derrière la nationalisation de la Société des mines de l’Aïr (SOMAÏR), annoncée le 19 juin 2025, se dessine un enchevêtrement de zones d’ombre que les autorités de Niamey peinent à dissiper.
Présentée comme un acte de reconquête des “richesses nationales”, la prise de contrôle par l’État nigérien de cette entreprise jusque-là détenue majoritairement par Orano (63,4 %) a été saluée par une partie de l’opinion comme un symbole de rupture avec l’ordre ancien. Mais cette lecture, largement portée par la junte au pouvoir, repose sur une narration simplificatrice qui escamote des réalités techniques, contractuelles et juridiques autrement plus complexes.
Contrairement à l’image parfois véhiculée d’un minerai que l’on pourrait extraire aisément, l’uranium n’est ni un produit de surface ni une ressource que l’on exploite à la pelle. Son extraction requiert un savoir-faire industriel pointu, des procédés chimiques sophistiqués (notamment la lixiviation), des installations lourdes, des contrôles radiologiques permanents et des infrastructures de transport hautement sécurisées. Historiquement, l’exploitation de l’uranium nigérien, via la SOMAÏR et auparavant la COMINAK, s’est inscrite dans cette logique industrielle exigeante, portée par des investissements colossaux et une expertise technique que peu d’acteurs maîtrisent.
Selon notre confrère Le Patriote Bénin, faire croire que cette ressource aurait été “bradée” ou exploitée sans rigueur relève donc, au mieux, d’une approximation, au pire, d’une stratégie de désinformation. D’autant que, selon des sources proches du dossier, les ventes d’uranium de la SOMAÏR s’effectuaient selon des mécanismes standards, conformes aux pratiques internationales : prix indexés sur les marchés mondiaux ou fixés annuellement à des niveaux proches des cours de référence. Ces modalités étaient arrêtées d’un commun accord entre les actionnaires, parmi lesquels figuraient des représentants de l’État nigérien via la SOPAMIN. Dans ces conditions, l’argument d’une sous-évaluation systématique des ventes apparaît pour le moins fragile.
Cette fragilité est d’autant plus manifeste que l’État nigérien n’était pas un spectateur passif de l’exploitation. En tant qu’actionnaire et administrateur, il participait aux décisions stratégiques, validait les mécanismes de tarification et bénéficiait directement des retombées économiques. Accuser aujourd’hui Orano d’avoir imposé des prix “dérisoires” revient implicitement à reconnaître une défaillance collective de gouvernance, voire à nier la responsabilité propre des autorités nigériennes dans la gestion passée du secteur.
Mais le point de rupture le plus préoccupant est survenu après la nationalisation. Un convoi d’uranium, sous forme de “yellowcake”, a quitté le site de la SOMAÏR sans qu’Orano n’en soit informée : ni sur les quantités transportées, ni sur la destination finale, ni sur l’identité des acheteurs. Cette opération, menée dans une opacité totale, constitue une violation manifeste des engagements contractuels liant les deux parties.
Plus grave encore, pour notre confrère, elle intervient en contradiction directe avec une décision du tribunal arbitral du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), rendue le 23 septembre 2025. Cette ordonnance interdisait explicitement à l’État nigérien de vendre ou de transférer l’uranium produit par la SOMAÏR tant que le litige avec Orano demeurait pendant. En procédant à ces expéditions, le gouvernement s’expose à de lourds préjudices financiers et juridiques, tout en fragilisant sa propre crédibilité internationale.
Dans ce contexte déjà tendu, l’annonce, le 2 décembre 2025, de la découverte supposée de “400 tonneaux de carotte radioactive” sur un site minier abandonné à Madaouela, près d’Arlit, est venue ajouter une dimension émotionnelle au dossier. Les autorités nigériennes ont aussitôt évoqué des “atteintes graves à l’environnement, à la santé publique et à la souveraineté nationale”, annonçant leur intention de porter plainte contre Orano.
Là encore, les faits demandent à être étayés. Orano réfute catégoriquement toute responsabilité, affirmant ne jamais avoir détenu de permis d’exploitation pour le site de Madaouela ni y avoir mené la moindre opération. En l’absence d’audit radiologique indépendant, de rapport environnemental contradictoire ou d’un historique clair des activités menées sur ce site, l’accusation ressemble davantage à un argument politique qu’à une démonstration scientifique rigoureuse.
Pour nombre d’observateurs, cette séquence s’inscrit dans une stratégie de justification a posteriori : légitimer la nationalisation, détourner l’attention des ventes contestées d’uranium et occulter d’autres interrogations sensibles, notamment celles relatives aux nouveaux partenariats stratégiques envisagés par Niamey, en particulier avec la Russie.
Ainsi, le dossier de l’uranium nigérien apparaît moins comme une simple affaire de souveraineté économique que comme un imbroglio où s’entremêlent considérations politiques, incertitudes juridiques et zones d’ombre opérationnelles. À vouloir transformer un litige commercial en croisade nationaliste, le Niger prend le risque d’affaiblir durablement la confiance des investisseurs et de compromettre la transparence d’un secteur vital pour son économie. À terme, c’est moins Orano que la crédibilité de la gouvernance minière nigérienne qui pourrait sortir durablement écornée de cette confrontation.


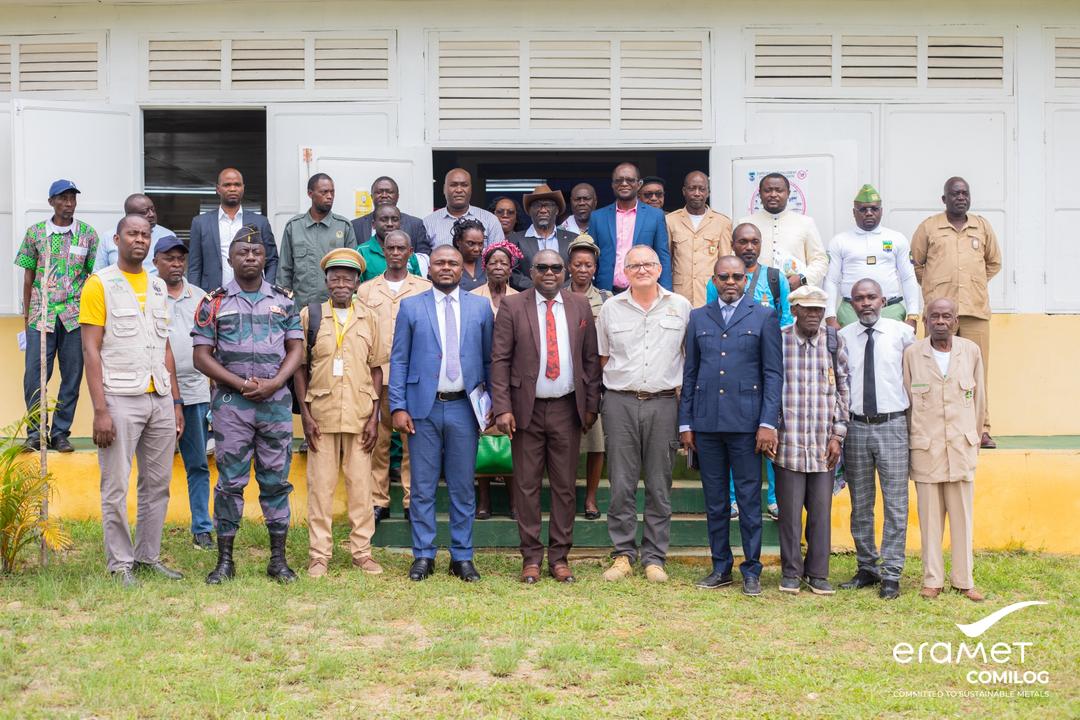











Laisser un commentaire