Mali: Choguel Maïga récuse toute “connivence” internationale avec le terrorisme
Par Stive Roméo Makanga
« Ni les USA, ni la Russie, ni la France, ni l’Algérie, ni le Maroc n’ont fait des accords et des pactes avec les terroristes… ». En une formule lapidaire, le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a voulu clore le débat : Bamako s’inscrit, affirme-t-il, dans une ligne de fermeté face aux groupes armés jihadistes qui sévissent au Sahel, et rejette l’idée de tractations secrètes avec eux. Cette prise de position, hautement politique, intervient alors que la lutte antiterroriste au Mali demeure au cœur des préoccupations sécuritaires et diplomatiques de la région.
En citant nommément de grandes puissances et des voisins influents, le chef du gouvernement malien cherche autant à rassurer l’opinion publique qu’à envoyer un message aux partenaires : la stratégie de Bamako s’aligne, dit-il, sur une doctrine internationale de non-négociation avec les groupes classés terroristes. Au plan interne, la déclaration vise à couper court aux rumeurs de “canaux parallèles” et à réaffirmer l’autorité de l’État dans la conduite des opérations de sécurité.
Depuis des années, la question d’éventuelles discussions — directes ou indirectes — avec des acteurs armés revient régulièrement dans le débat sahélien, entre partisans d’un compromis local pour soulager les populations et tenants d’une ligne dure estimant qu’aucune paix durable ne peut naître d’arrangements avec des organisations responsables d’attaques contre civils et forces de défense. La déclaration de M. Maïga se situe clairement dans le second camp : ni accommodements, ni zones grises.
La référence explicite aux États-Unis, à la Russie, à la France, ainsi qu’à l’Algérie et au Maroc, n’est pas anodine. Elle place la posture malienne dans un continuum international, tout en rappelant l’importance des voisins du Maghreb dans la médiation régionale et le contrôle des frontières. Le message sous-entendu : le Mali veut conjuguer souveraineté stratégique et coopération, mais sur une base de principes, sans concessions aux groupes terroristes.
Sur le plan de la communication publique, la séquence s’apparente à une “clarification d’autorité” : le gouvernement se montre ferme, assume une lecture sécuritaire de la crise et se réserve la maîtrise du calendrier comme des canaux de dialogue — lesquels, précise-t-on en filigrane, concernent les communautés, les notabilités locales et les acteurs institutionnels, non les groupes listés comme terroristes.
Reste l’épreuve des faits. La ligne de fermeté suppose :
* la continuité des opérations de sécurisation des axes et des localités ;
* la montée en puissance des forces locales et la coordination avec les partenaires régionaux ;
* un soutien soutenu aux populations (services de base, justice, développement) pour assécher le vivier de recrutement des groupes armés.
C’est sur ces terrains – sécurité, gouvernance, services publics -que la crédibilité du discours sera jugée.
Dans un contexte de transition, chaque mot compte. En récusant tout “pacte”, Bamako cherche à verrouiller sa doctrine et à éviter que des initiatives locales ne soient interprétées comme des concessions. Mais l’équation demeure délicate : conjuguer pression militaire, résilience des institutions et réponses socio-économiques, sans fermer la porte aux mécanismes de réconciliation communautaire.
En bref, la sentence de Choguel Maïga s’inscrit dans une stratégie de fermeté assumée : pas d’arrangements avec les groupes terroristes, alignement revendiqué sur une norme internationale, et recentrage de la légitimité étatique. L’opinion, elle, attendra la traduction concrète de cette ligne dans la durée, sur les routes, dans les villages et dans les services rendus au quotidien.

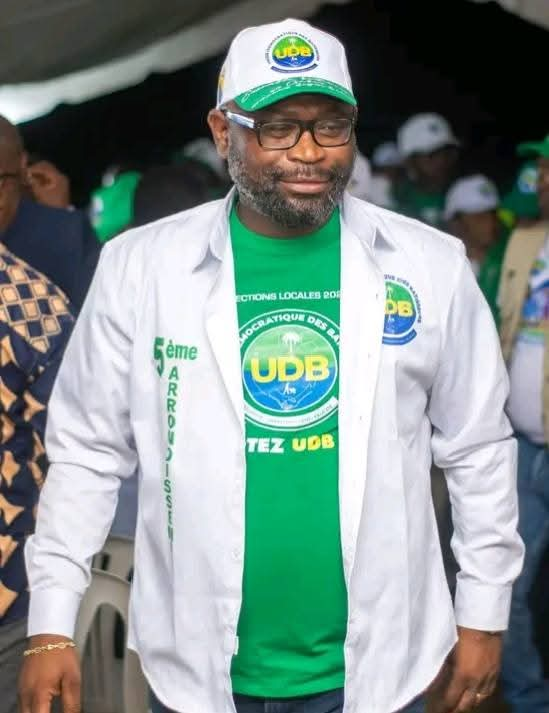











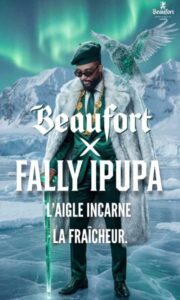
Laisser un commentaire