Gabon/Transparence et engagement : la CNLCEI pilote le lancement du second cycle d’évaluation de la Convention onusienne anticorruption
Par Stive Roméo Makanga
C’est dans une ambiance studieuse, presque solennelle, que Nestor Mbou, président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (CNLCEI), a donné, le 20 octobre 2025 dernier, le coup d’envoi du deuxième cycle du mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC). Entouré des représentants des administrations et institutions concernées, le patron de la CNLCEI a ouvert la phase nationale d’auto-évaluation, première étape d’un processus exigeant où le Gabon sera évalué par le Tchad et la Libye.
Adoptée en 2003, la CNUCC impose à ses États parties de se soumettre périodiquement à un examen en deux temps : l’auto-évaluation, puis l’évaluation par les pairs. Ce mécanisme vise à mesurer les progrès réalisés, identifier les obstacles à l’application de la Convention et déterminer les besoins d’assistance technique. Chaque examen donne lieu à un rapport de pays (dense et minutieux) et à un résumé analytique publié sur le site de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
La CNLCEI, institution pivot du dispositif national, assure la coordination de ce processus, en veillant à la participation effective des différents secteurs concernés. Cette implication interinstitutionnelle est capitale : sans elle, le mécanisme d’évaluation, aussi rigoureux soit-il, risquerait de n’être qu’un exercice bureaucratique de plus.
Lors du premier cycle, en avril 2015, le Gabon avait été passé au crible par la Sierra Leone et le Laos. Le rapport de l’époque relevait d’importantes lacunes : l’absence d’incrimination de la corruption d’agents étrangers, la faiblesse du dispositif de protection des témoins, et la responsabilité limitée des personnes morales. Depuis, quelques réformes ont été engagées, mais l’essentiel reste à consolider.
Le deuxième cycle d’examen, qui porte notamment sur la prévention et le recouvrement des avoirs, interroge le degré d’application de l’un des principes fondamentaux de la Convention : la restitution des fonds publics volés. Le chapitre V, considéré comme « l’article vendeur » du texte onusien, propose aux États un cadre juridique complet pour rechercher, geler et restituer les avoirs issus d’actes de corruption. Dans la plupart des cas, les fonds recouvrés sont restitués à l’État d’origine ou directement aux victimes, lorsque celles-ci sont identifiées.
Le processus d’évaluation, orchestré par l’ONUDC, se déploie en trois phases. D’abord, l’auto-évaluation : le pays remplit une liste de contrôle standardisée. Ensuite, l’examen par les pairs : deux États tirés au sort (le Tchad et la Libye pour le Gabon) analysent les réponses, échangent avec le point focal national et peuvent effectuer une visite sur le terrain. Enfin, la rédaction du rapport d’examen, suivie d’un résumé analytique, dont la publication permet une lecture publique du niveau de conformité du pays.
L’impact de ce mécanisme n’est pas qu’administratif : il favorise les réformes législatives, stimule le dialogue entre institutions, encourage le partage de bonnes pratiques et attire l’attention des bailleurs de fonds sur les besoins d’assistance technique prioritaires. Déjà, des séances de travail ont eu lieu entre la CNLCEI et plusieurs administrations sectorielles afin d’affiner le rapport d’auto-évaluation.
Reste une question, lourde de sens : dix ans après le premier rapport de l’ONUDC, les recommandations de 2015 ont-elles été réellement appliquées ? Dans un pays où la corruption s’est faite système, la réponse à cette interrogation dira sans doute si le Gabon entend faire de la transparence un simple mot d’ordre ou un véritable engagement d’État.



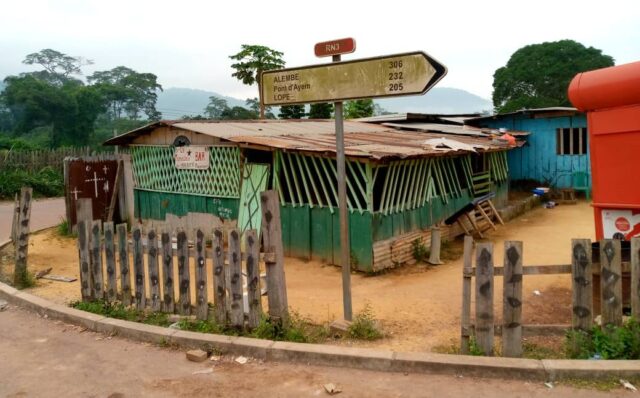






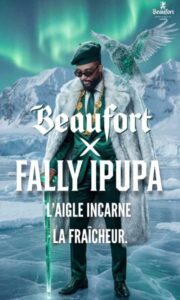



Laisser un commentaire