Construction de centrales nucléaires en Afrique : chronique d’une promesse qui court après le temps
Par Stive Roméo Makanga
On annonce depuis des lustres « l’arrivée » du nucléaire en Afrique comme on annonce un invité de marque : avec trompettes, communiqués et photos officielles. Sur le terrain, la réalité ressemble souvent à une parade : mémorandums signés, discours enthousiastes, tablettes de voyages ministériels… et, plus rarement, des chantiers qui tiennent la route. Moscou, qui a multiplié les accords de coopération nucléaire avec une vingtaine de pays africains ces dernières années, en sait quelque chose : les promesses diplomatiques y abondent, les réalisations beaucoup moins.
L’exemple égyptien d’El-Dabaa ( souvent brandi comme modèle) est le seul projet de grande ampleur qui ait réellement franchi le stade de la signature pour atteindre la construction. C’est un monstre financier et logistique : quatre réacteurs VVER-1200 pour un coût avoisinant les 28–29 milliards de dollars, financés à près de 85 % par un prêt russe. Une démonstration de capacité ? Plutôt une exception qui confirme la règle : et un instrument d’influence.
La tentation d’appliquer le « modèle El-Dabaa » ailleurs se heurte cependant à des réalités structurelles. Prenons le Niger, pays sahélien récemment au centre des attentions après la signature, en juillet 2025, d’un accord de coopération civile avec la Russie. Sur le papier, les ambitions sont grandioses : concevoir une filière civile. Dans la pratique, la route est semée d’obstacles.
D’abord le réseau électrique. Les acheminements, la capacité de transport et la résilience des systèmes actuels sont insuffisants pour intégrer sans rupture la production d’un réacteur conventionnel: a fortiori d’un parc de réacteurs. Les documents de la Banque mondiale et les programmes régionaux insistent : pour électrifier et stabiliser des réseaux sahéliens, il faut d’abord investir massivement dans la transmission et la distribution, et non seulement planter des cuves à combustible. En clair : sans renforcement préalable du réseau, la centrale resterait une usine à produire de l’électricité sans moyen sûr de la livrer.
Ensuite, le nerf de la guerre : l’argent. Le montage financier d’El-Dabaa – prêt d’État russe couvrant l’essentiel du coût – est hors de portée d’un État dont le budget général dépasse à peine quelques milliards de francs CFA : le budget nigérien pour 2025 a été arrêté à environ 3 033,33 milliards de francs CFA (rectifié ensuite à \~2 749,55 milliards), soit quelques milliards de dollars au mieux: chiffres qui relativisent brutalement toute ambition nucléaire à court terme. Comparer le Niger à l’Égypte, dont le projet repose sur des financements massifs et des structures étatiques radicalement différentes, relève de la mauvaise foi ou de la naïveté politique.
Vient ensuite la question humaine : les compétences. Un programme civil nucléaire exige ingénieurs, autorités de sûreté indépendantes, régulateurs formés et une main-d’œuvre qualifiée: des actifs qui se construisent sur des générations. Les formations évoquées dans les communiqués, souvent à l’étranger, ressemblent plus à des gestes symboliques qu’à une stratégie nationale de formation industrielle. Le déficit est tel qu’il rend illusoire toute montée en charge rapide : il faudra une ou deux générations pour rapprocher l’effectif local des standards requis.
Enfin, et c’est le point politique : quelle est la logique réelle derrière ces accords ? Derrière le verbe haut sur « transfert de technologie » et « souveraineté énergétique », se profile souvent un intérêt plus prosaïque et géopolitique : sécuriser des approvisionnements en uranium et obtenir des permis miniers, au profit de grands groupes (et de l’État fournisseur) plutôt que d’établir immédiatement une filière civile pleinement autonome et durable. Un partenariat qui profite surtout, à court terme, au contractant extérieur.
Si l’on parle d’urgence énergétique au Sahel, la réponse pragmatique est ailleurs. Les renouvelables (solaire et éolien) sont déployables rapidement, modulables, moins coûteuses à l’hectare et surtout plus cohérentes avec des réseaux qui ont d’abord besoin d’extensions et de fiabilité. Pour des besoins immédiats d’électrification et de relance économique, miser sur des parcs photovoltaïques distribués et sur l’interconnexion régionale relève moins de l’idéalisme dogmatique que de la simple intelligence politique.













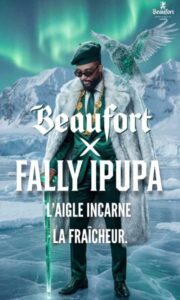
Laisser un commentaire