Crise sécuritaire dans le Sahel : Moscou appelle la communauté internationale à l’aide
Par Stive Roméo Makanga
Le Sahel est en proie à une crise sécuritaire grave et éloquente : montée des insurrections jihadistes, instabilité politique, déplacement massif de populations, et effondrement parfois des services publics. Dans ce contexte, la Russie, de plus en plus présente dans la région, semble à la fois offrir son soutien direct aux États sahéliens et suggérer un besoin de coopération internationale accrue.
En effet, depuis plusieurs années, la Russie a accru sa visibilité dans le Sahel, que ce soit par le biais du groupe paramilitaire Wagner, maintenant relayé par Africa Corps, ou par des accords de coopération militaire, notamment avec les États récemment passés sous régime militaire (Mali, Burkina Faso, Niger).
En avril 2025, lors d’une réunion à Moscou avec les ministres des affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré l’engagement de la Russie à aider ces pays dans la lutte contre les groupes jihadistes. Ce soutien comprend la formation des troupes, la fourniture d’équipements militaires, et la consolidation de la capacité opérationnelle de la force conjointe sahélienne.
Aujourd’hui, de façon presque subtile, la Russie fait part de sa volonté de coopérer davantage. Les annonces ne se présentent pas clairement comme un “appel à l’aide” dans le sens traditionnel certes, mais elles le sous-entendent. On peut même affirmer sans risque de se tromper que le camp de Vladimir Poutine formule une demande assez explicite de ressources ou d’intervention multilatérale en provenance de pays tiers. Cependant, plusieurs indices suggèrent que Moscou cherche non seulement à consolider son propre rôle, mais aussi à inviter d’autres acteurs à agir de concert :
– La formation d’une Alliance des États du Sahel, souvent évoquée dans les communiqués, est présentée comme une coopération régionale portée vers une réponse collective contre les menaces sécuritaires.
– La Russie a aussi proposé d’aider non seulement au niveau militaire, mais par des mesures techniques et diplomatiques, ce qui suppose un travail collaboratif avec d’autres partenaires internationaux. Tout est donc limpide.
Malgré ces promesses, la participation de la Russie soulève plusieurs questions :
D’abord au niveau des droits humains. En effet, des rapports font état d’abus commis par des forces liées à la Russie (via Wagner, Africa Corps) dans des opérations contre-insurrectionnelles. Ces abus concernent des civils, des arrestations arbitraires, des exécutions, ce qui entache les déclarations de soutien sécuritaire.
Ensuite, il y a la véracité stratégique. Certains analystes estiment que les promesses russes servent autant ses ambitions géopolitiques que l’intérêt sécuritaire pur. La Russie pourrait ainsi tirer parti de la (relative) vacance ou retrait des puissances occidentales pour accroître son influence
Enfin, la capacité opérationnelle. La multiplicité des groupes insurgés, la géographie difficile, les dynamiques ethniques et l’instabilité politique compliquent fortement toute action militaire efficace. Le soutien matériel et en formation est utile, mais souvent insuffisant sans bonne gouvernance, enracinement local et soutien civil.
Si la Russie “appelle” implicitement à l’aide ou du moins suggère la nécessité d’une mobilisation élargie, voici ce que pourrait impliquer un tel appel :
Nous avons le renforcement des financements humanitaires pour les populations affectées, déplacées ou en insécurité alimentaire.
Le support logistique, de renseignement, et de formation (en partenariat avec les États sahéliens) pour les forces locales, dans le respect des droits humains.
Sans oublier la coopération multilatérale via l’ONU, l’Union africaine, la CEDEAO, l’UE et d’autres acteurs pour coordonner les efforts, d’une part.
Et la meilleure diplomatie de prévention : résoudre les causes profondes (pauvreté, inégalité, climat, gouvernance), pas seulement réagir aux attaques, d’autre part.
Aujourd’hui, il n’est pas exagéré de dire que la Russie, déjà un acteur clé dans la crise sécuritaire sahélienne, semble de plus en plus mettre en avant l’idée d’une coopération plus vaste. Si cet “appel” n’a pas été formulé en termes formels publics jusqu’à présent, le contexte indique qu’elle souhaite que la communauté internationale ne se contente pas de laisser seuls les États locaux face à l’insurrection.
L’urgence ne permet plus le statu quo. Pour le Sahel, la sécurité est un combat de tous et chaque acteur international doit envisager son rôle, ses responsabilités, et s’engager avec transparence, efficacité et validité éthique. Dans cette perspective, il paraît évident que Moscou est à bout de souffle.

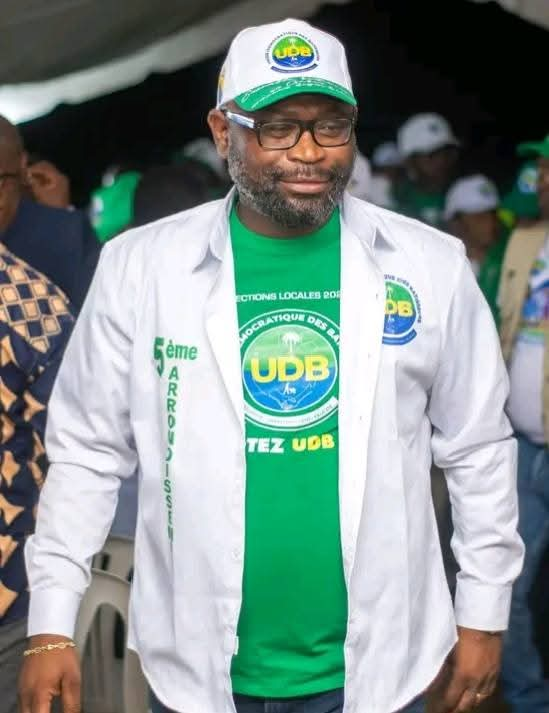











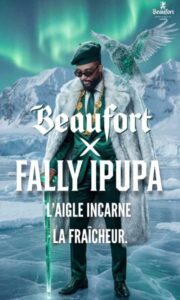
Laisser un commentaire