De Wagner à Africa Corps : l’implantation durable et stable de la Russie au Sahel et en Afrique
Par Stive Roméo Makanga
Il y a, dans les grandes manœuvres diplomatiques, un art consommé du spectacle : la photo de la délégation, le ruban tricolore, le communiqué triomphant. Mais lorsqu’on descend des tribunes et que l’on regarde la carte, l’implantation russe au Sahel et en Afrique ressemble à autre chose : un savant mélange d’ingénierie militaire, de contrats sécuritaires, d’exploitation des ressources et d’influence politique, mis en musique par des forces paramilitaires dont la plus célèbre, Wagner, a récemment cédé une partie de la scène à une structure plus contrôlable par le Kremlin: l’« Africa Corps ».
Ce transfert d’étiquette n’est pas anecdotique. Après la crise interne de 2023 et la disparition de son leader, Wagner n’est plus l’entité quasi-privée qu’elle fut : Moscou a entrepris de rationaliser et d’institutionnaliser sa présence en Afrique, au travers d’organes plus directement assujettis à l’appareil d’État. Le recours à l’Africa Corps illustre une logique simple et durable : garder les atouts (formation, appui opérationnel, sécurité rapprochée des régimes alliés) tout en réduisant la part d’imprévisibilité politique qu’un acteur semi-privé pouvait introduire.
Sur le terrain, ce recalibrage se traduit par une présence continue et souvent massive dans des pays sortis de la tutelle occidentale. Mali, Burkina Faso, Niger, Centrafrique : les régimes militaires qui ont émergé ces dernières années trouvent dans ces « partenariats » un filet de soutien immédiat (entraînement, matériel, sécurité rapprochée) que les partenaires traditionnels peinent à fournir sans conditions politiques jugées inacceptables pour les juntes. Le résultat est net : la Russie gagne du terrain stratégique, obtient des contrats d’accès aux ressources minières, et érige une relation clientéliste durable, fondée autant sur la contrainte que sur l’intérêt mutuel.
Il faut pourtant résister à deux illusions. La première est celle de l’efficacité exclusive : ces opérateurs russes ne sont pas des miracles de sécurité. Les crimes, les excès et l’absence de résultats durables en matière de pacification sont documentés. L’appui militaire n’a pas effacé les fractures sociales, ni résolu l’épineuse question du contrôle territorial à long terme. La seconde illusion est celle d’un gain uniforme pour les pays hôtes : si certains gouvernements tirent un avantage tactique immédiat, la dépendance à des acteurs étrangers (qui tirent profit de concessions minières et d’accords opaques) finit par fragiliser la souveraineté économique et politique à moyen terme.
Le choix russe n’est pas seulement militaire : il est économique et géopolitique. En échange de « sécurité », des entreprises proches du pouvoir russe obtiennent des concessions, participent à l’extraction de minerais stratégiques et installent une présence économique durable. C’est ce qui rend l’opération profitable pour Moscou : un investissement à plusieurs registres (militaire, commercial, diplomatique) qui réclame peu de transparence et rapporte beaucoup en influence. Les États africains, souvent en quête de solutions rapides à des crises immédiates, acceptent des termes qui, à la longue, peuvent s’avérer contraignants.
Que faire, dès lors, face à cette réalité ? La réponse n’est pas l’affrontement direct — encore moins la nostalgie d’un ordre ancien qui n’existe plus — mais la reconquête des marges de manœuvre. Il faut d’abord renforcer la diplomatie multilatérale et l’action préventive : investissements massifs dans le développement local, coopération sécuritaire conditionnée par le respect des droits et par la transparence, soutien aux capacités étatiques (justice, police, services publics). Ensuite, il faut cesser de croire qu’il existe une formule magique : la stabilité ne s’achète pas avec des bataillons étrangers ; elle se construit avec l’inclusion, l’emploi et la gouvernance.
Enfin, une vérité froide s’impose : l’implantation russe au Sahel n’est pas un feu de paille. Qu’on l’appelle Wagner ou Africa Corps, elle a pris une forme institutionnelle et pragmatique qui, faute d’alternatives crédibles, est en passe de devenir un facteur stable du paysage régional. La réaction occidentale (oscillant entre sanctions, pressions et réengagements timides) peine à offrir une réponse cohérente et rapide. Tant que les États africains ne disposeront pas de vraies options locales et régionales, les espaces d’influence extérieure resteront ouverts.
Il faudra donc plus que des condamnations diplomatiques : une stratégie qui relie sécurité et développement, qui propose des alternatives crédibles et rapides, et qui refuse les arrangements opaques. Sans cela, la recomposition stratégique à l’œuvre au Sahel continuera de produire une réalité inquiétante : des États faibles substituant la logique du contrat militarisé à celle du contrat social. Et l’on aura beau changer les noms ( Wagner, Africa Corps ) la nature du phénomène restera la même : une emprise lente, souvent rentable pour l’étranger, rarement bénéfique pour les populations.













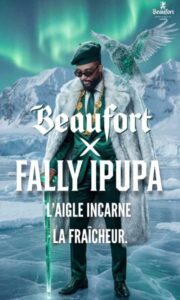
Laisser un commentaire