[Editorial] Souveraineté, chantiers, ambitions : la Ve République à l’épreuve de l’économie
Par Stive Roméo Makanga
Le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance n’a pas servi qu’à la commémoration des dates : il a été choisi, par la parole du Chef de l’État, comme le moment d’une clairvoyance stratégique. En plaçant la souveraineté économique au cœur de la Ve République, Brice Clotaire Oligui Nguema ne se contente pas d’une formule. Il dessine une ambition — haute, contraignante, exigeante — qui conditionne à la fois l’identité politique du pays et la méthode de gouvernance à venir.
Affirmer que « notre cinquième République doit être la République de la souveraineté économique » n’est pas un slogan ; c’est une promesse de redéploiement de la maîtrise nationale sur les ressources, et, par conséquent, sur le destin collectif. Fixer un objectif de croissance à 10 % est audacieux ; il est aussi pédagogique : il impose une lecture réaliste (discipline budgétaire, adhésion au travail, probité, cohésion et méthode) autant de qualités que la décennie passée a souvent mises à l’épreuve. Mais au-delà des mots, la crédibilité de cette ambition dépendra de l’architecture institutionnelle et de la constance d’exécution.
Sur un plan politique, la communication a été habile : rappeler que « nous avons réglé de nombreuses dettes sociales » et que « nous avons mis tout le pays en chantier » permet de capitaliser sur les acquis de la transition, en offrant un récit de sortie de crise et de reprise. Cet héritage d’apurement n’est pas seulement comptable ; il est un levier de confiance indispensable pour attirer investisseurs et partenaires. Reste à transformer cette confiance en investissements productifs, et non en dépenses ponctuelles.
La nouveauté la plus salutaire est sans doute l’inscription d’une planification territoriale forte, assortie d’un plan de développement communautaire 2026-2032. Dans un pays où les ressources sont concentrées et où les inégalités territoriales persistent, la promesse d’une répartition équitable des investissements publics est un impératif démocratique autant qu’un instrument de paix sociale. Admettre que « nous ne pouvons tout réaliser simultanément et partout à la fois » relève d’un pragmatisme rare dans les discours officiels : la priorisation, si elle est sincère, est la condition d’une gouvernance rationnelle et durable.
La jeunesse, enfin, est traitée comme un vecteur central et non comme un simple public électoral. Le fonds d’aide à l’entrepreneuriat et à l’agriculture de 25 milliards de francs et l’annonce d’un vaste programme de digitalisation (10 000 ordinateurs) sont des mesures pertinentes, à condition qu’elles s’accompagnent d’un écosystème : formation professionnelle, accès au marché, accompagnement financier et réduction des obstacles réglementaires. Sans cela, les dispositifs risquent de rester des coques vides, séduisantes en discours mais inefficaces en résultat.
Trois défis majeurs se profilent et détermineront la réussite (ou l’échec) de ces grandes lignes.
Premier défi : l’exécution. La planification sans contrôle exigeant, sans indicateurs clairs ni mécanismes transparents de reddition des comptes, demeure lettre morte. Il faudra des calendriers précis, des évaluations indépendantes et une gouvernance partenariale impliquant les collectivités locales.
Deuxième défi : la vocation productive des investissements. Atteindre 10 % de croissance n’est pas seulement une question de dépenses publiques ; c’est une question de transformation structurelle — diversification, montée en gamme industrielle, soutien à l’agro-business et à l’entrepreneuriat innovant. L’État doit créer les conditions d’un marché compétitif et d’une chaîne de valeur nationale.
Troisième défi : la lutte contre la corruption et pour la probité. La souveraineté économique proclamée ne prendra sens que si les ressources sont gérées avec transparence et au service du bien commun. Les mots du Président — discipline, probité — sont donc bien choisis ; encore faut-il qu’ils soient suivis d’actes irréprochables et de sanctions visibles.
L’heure est à la méthode. La Ve République naît d’une promesse : faire du Gabon un pays qui exploite ses richesses pour le bien de tous. Les outils annoncés — planification territoriale, fonds pour la jeunesse, digitalisation — peuvent y contribuer. Mais au fond, la réussite dépendra d’un trait immatériel : la capacité collective à transformer des intentions solennelles en routine administrative, en pratiques de gouvernance et en projets palpables sur le terrain.
Si la parole présidentielle a tracé la boussole, il revient maintenant aux acteurs publics, au secteur privé et à la société civile de la traduire en actes. Car une République souveraine n’est pas seulement celle qui contrôle ses ressources : c’est celle qui fait de cette maîtrise un bien partagé, mesurable, et durable. Le Gabon l’a voulu ; il lui reste à le démontrer.

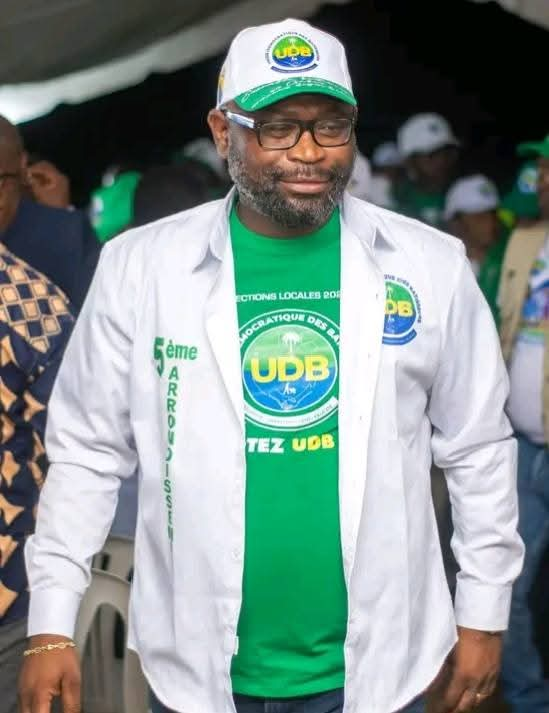











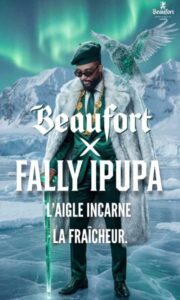
Laisser un commentaire