La leptospirose : une infection silencieuse transmise par les rats
Par Cadette Ondo Eyi
Infection bactérienne potentiellement grave, la leptospirose continue de sévir dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales, mais également dans certains milieux urbains insalubres. Souvent méconnue du grand public, cette zoonose représente pourtant un risque sanitaire réel, notamment en période de fortes pluies ou d’inondations.
La leptospirose est une maladie infectieuse d’origine bactérienne, causée par des bactéries du genre Leptospira. Elle est classée parmi les zoonoses, c’est-à-dire les maladies transmissibles de l’animal à l’homme. L’infection survient le plus souvent à la suite d’un contact direct avec l’urine d’animaux infectés — principalement les rongeurs, et notamment les rats — ou par contact indirect via de l’eau ou de la boue contaminées.
Les bactéries peuvent pénétrer dans l’organisme humain par les muqueuses ou par des lésions cutanées, même minimes. Ce mode de transmission rend la maladie particulièrement redoutable dans les environnements humides et insalubres, notamment dans les zones urbaines défavorisées ou les zones rurales mal assainies.
Le tableau clinique de la leptospirose est souvent insidieux. Après une période d’incubation de 4 à 14 jours, les premiers symptômes apparaissent : fièvre brutale, frissons, douleurs musculaires intenses, maux de tête, nausées, voire conjonctivite. Ces manifestations peuvent évoquer une grippe, ce qui complique souvent le diagnostic.
Dans environ 10 % des cas, la maladie évolue vers une forme sévère. Celle-ci peut entraîner une atteinte hépatique (ictère), une insuffisance rénale aiguë, des hémorragies internes, voire des troubles neurologiques. L’évolution peut être fatale en l’absence de prise en charge rapide et appropriée.
Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments cliniques, épidémiologiques et biologiques, avec confirmation par analyses sérologiques ou PCR. Dès la suspicion de leptospirose, une antibiothérapie doit être initiée sans délai, souvent à base de doxycycline ou de pénicilline.
Dans les formes graves, l’hospitalisation est indispensable, notamment en service de réanimation, pour assurer un traitement de soutien (dialyse, transfusion, traitement des complications hémorragiques).
La prévention de la leptospirose repose avant tout sur des mesures d’hygiène et de salubrité publique. Il est essentiel de : lutter contre la prolifération des rongeurs ; éviter le contact avec des eaux stagnantes ou potentiellement contaminées ; porter des équipements de protection (gants, bottes) lors de travaux agricoles, d’entretien ou de nettoyage en zones à risque ; assainir les zones d’habitat précaire et améliorer l’accès à l’eau potable.
La leptospirose, bien que souvent négligée, demeure une menace sérieuse pour la santé publique, particulièrement dans les contextes de précarité ou de catastrophes naturelles. Elle exige une vigilance constante, une prise de conscience collective, ainsi qu’un renforcement des infrastructures sanitaires dans les zones vulnérables.
En somme, la lutte contre cette maladie passe par une synergie entre prévention, éducation sanitaire, surveillance épidémiologique et réponse médicale rapide. Car si la leptospirose est guérissable, son pronostic dépend étroitement de la précocité du diagnostic et de l’efficacité de la prise en charge.










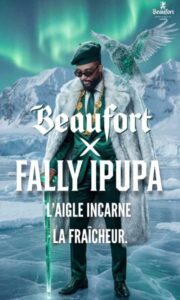



Laisser un commentaire