Procès Sylvia et Noureddin Bongo : Yann Koubdjé pouvait-il dire « Non »?
Par Stive Roméo Makanga
Il est des procès qui dépassent la seule technicité judiciaire pour s’inscrire, avec la force implacable des tournants historiques, dans la mémoire longue d’une nation. Celui de Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddin Bongo Valentin, qui vient de s’achever à Libreville, appartient incontestablement à cette catégorie rare de moments où un pays, presque malgré lui, se regarde enfin dans le miroir de sa propre histoire récente. Pendant plusieurs jours, la Cour criminelle spécialisée a mis à nu non seulement des individus, mais un système, une matrice de prédation qui a façonné le Gabon de la dernière décennie.
Ce procès, qualifié d’emblée d’historique, l’aura été non seulement pour l’ampleur des sommes évoquées, pour la stature des accusés ( un ancien premier cercle présidentiel devenu, par la magie soudaine de la chute, justiciable ordinaire ), mais également pour les révélations stupéfiantes distillées à la barre par certains coaccusés. Des révélations qui, pour la première fois, ont permis d’entrevoir ce que nombre de Gabonais soupçonnaient sans jamais pouvoir le démontrer : l’existence, au cœur de l’appareil d’État, d’un réseau structuré, d’une mécanique disciplinée de captation des richesses publiques, entièrement pilotée depuis les alcôves de la « Young Team », ce cénacle feutré où Sylvia Bongo Ondimba et son fils régnaient comme des chefs de famille dans un clan où l’obéissance n’était pas une vertu mais une condition de survie.
Parmi ceux qui ont parlé et donné des noms, l’un a particulièrement retenu l’attention : Yann Koubdjé, l’ancien Trésorier Payeur Général. L’homme, décrit parfois comme l’un des rouages essentiels du dispositif, a été présenté non pas comme un stratège de l’ombre mais comme un exécutant, un passager sans gouvernail dans un navire dont il ignorait la destination mais dont on exigeait qu’il alimente en permanence les moteurs. Les révélations faites à la barre à son sujet auront mis en évidence ce qu’un État failli peut produire de plus dévastateur : des hauts fonctionnaires pris en otage par une hiérarchie politique qui confondait volontiers l’argent public avec un patrimoine privé. Yann Koubdjé a agi, oui. Mais a-t-il décidé ? A-t-il initié ? Rien ne permet aujourd’hui de l’affirmer. Tout, en revanche, indique qu’il n’était que l’un de ces maillons instrumentalisés, condamnés au silence par la peur et par l’omniprésence d’un pouvoir sans contrepoids.
C’est là, d’ailleurs, l’un des enseignements les plus sombres de ce procès : qui, en réalité, pouvait dire non à Sylvia Bongo ou à son fils ? Qui, dans cette architecture pyramidale où chaque refus équivalait à un acte d’insoumission, pouvait se permettre de s’opposer à la volonté de la « Young Team » ? À écouter les témoignages qui se sont succédé, l’on mesure à quel point le système était entièrement verrouillé. Ceux qui, par conviction ou par prudence, avaient tenté d’opposer un refus poli ou de ralentir la machine, ont très vite appris que le Gabon de cette époque n’avait plus rien d’un État, mais tout d’un cartel politique, jaloux de ses privilèges, violent dans ses sanctions.
Le cas de Brice Laccruche Alihanga plane d’ailleurs comme un avertissement tragique au-dessus de ce procès. L’ancien directeur de cabinet, dont les relations avec le premier cercle présidentiel s’étaient brutalement refroidies à partir de 2019, avait osé dire non. Ou du moins, il avait cessé de dire oui. Il avait, dit-on, critiqué certaines dérives, mis en garde contre des décisions imprudentes, tenté de limiter l’expansion de ce clan familial qui s’était arrogé les caisses, les leviers, les réseaux et jusqu’aux consciences. Le résultat est connu : la prison, puis la maladie, puis la dérive carcérale dont beaucoup estiment qu’elle n’avait rien d’un hasard. Ceux qui dérangeaient étaient neutralisés, physiquement parfois, institutionnellement toujours.
Car c’est bien cela que le procès a révélé dans sa nudité la plus brutale : un système mafieux, minutieusement agencé, où la captation de fonds publics n’était pas une anomalie mais une règle de fonctionnement. Un système où la loyauté ne se mesurait pas à l’intérêt de la nation, mais à la capacité de chacun à exécuter, sans question, sans scrupule, les ordres venus d’en haut. Un système où l’État, dépouillé de sa colonne vertébrale, se retrouvait réduit à n’être qu’un immense guichet familial.
Le Gabon, aujourd’hui, tente de se reconstruire. Mais pour se réformer, un pays doit d’abord comprendre ce qui l’a détruit. Ce procès, immense par son symbole et essentiel par sa portée, aura au moins permis cela : mettre des mots sur l’indicible, donner un visage au non-dit, exposer à la lumière ce qui prospérait dans l’ombre. Et rappeler, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que la justice n’est pas seulement une institution : elle est une chance de tourner la page, oui. Mais surtout de ne plus jamais l’oublier. Yann Koubdjé ne pouvait pas dire « non ». Chacun de nous sait pertinemment ce qu’il se serait passé pour lui: la prison, et peut-être comme Brice Laccruche Alihanga, le cancer en bonus.





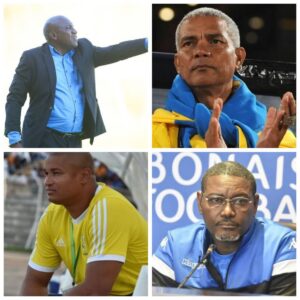








1 commentaire